
Projet de Constitution du 30 juin 2025: Un texte porteur de promesses, à l’épreuve de notre réalité
Le 21 septembre, il nous est proposé, en tant que citoyens, de nous prononcer sur le projet de Constitution publié au Journal Officiel de la République en date du 30 juin 2025. Cette édition, gratuite, est censée être accessible en ligne — du moins lorsque le site est à jour : https://www.sgg.gov.gn/document/journal/1.
La lecture attentive de ce texte m’a procuré des émotions contrastées : d’un côté, un sentiment de fierté et d’optimisme, inspiré par les principes fondateurs affirmés et la vision d’ensemble qu’il dessine ; de l’autre, une forme d’angoisse mêlée à un réalisme désabusé face à notre capacité, en tant que collectivité nationale, à respecter loyalement ces engagements ambitieux.
Je laisse aux juristes et aux spécialistes du droit constitutionnel le soin d’évaluer la légalité et la cohérence technique du texte. Pour ma part, sans prétention académique, je me contente de livrer quelques réflexions citoyennes, issues d’une lecture laborieuse mais sincère, nourrie par l’espoir - toujours vivant - de voir la Guinée s’extraire enfin de la récurrence de régimes successifs,souvent honnis, parce qu’aux yeux de nombreux compatriotes, ils ont loupé leurs sorties... si ce n’est leurs entrées.
Du préambule
Le préambule du projet de Constitution 2025 affiche des intentions louables, en affirmant vouloir « tirer les leçons de notre histoire », respecter « la primauté de l’ordre constitutionnel » et bâtir un État de droit garantissant la liberté d’expression, y compris l’opposition légale à l’action du Gouvernement.Il met également en avant des engagements actuels forts, tels que la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre les crimes économiques et la préservation des ressources nationales.
Toutefois, ces proclamations, aussi nobles soient-elles, rappellent celles déjà formulées dans les précédentes constitutions, sans toujours avoir été suivies d’effets concrets.
La portée de ces engagements dépendra donc moins de leur formulation que de la volonté politique réelle de les traduire dans les faits, pour qu’enfin ces principes cessent d’être de simples déclarations d’intention.
En tant que citoyen, je reste conscient que notre parcours collectif n’a pas toujours reflété une pleine fidélité à l’ordre constitutionnel, ni une mobilisation constante pour faire prévaloir le droit face aux abus de pouvoir. Les leçons de notre histoire semblent encore en cours d’assimilation, et notre recours aux voies légales pour exprimer nos désaccords a souvent manqué de retenue,de constanceet d’efficacité. Cela dit, je partage pleinement – comme de nombreux compatriotes – les déclarations du projet de constitution quant à l’adhésion claire et ferme à la démocratie, au rejet de toute forme anticonstitutionnelle d’accession, de maintien ou de transmission du pouvoir, ainsi que de toute pratique fondée sur la dictature, l’injustice, le régionalisme, l’ethnocentrisme ou le népotisme. Cette affirmation de principe constitue, à mes yeux, un socle essentiel pour bâtir une démocratie plus juste, plus inclusive et résolument tournée vers l’avenir.
De l’Etat, des principes fondamentaux de la République, des droits et devoirs.
L’affirmation de la souveraineté (titre 1,art.1)est une tradition guinéenne bonne à rappeler après 67 ans d’indépendance. Elle est dans l’air du temps, de l’affirmation des Etas africainset du refus de la satellisation. Il est également bon de rappelerle rôle de l’Etat dans l’éducation civique des citoyens,la valorisation de nos langues nationaleset la participation de la société civile pour ce faire.L’encadrement des partis politiques, les exigences d’inclusion, de diversité, de parité, de reddition et d’alternance démocratique en leurs seins dépendront de la qualité de la loi organique qui sera élaborée, mais pas seulement. La tradition d’un exécutifrégalien qui commande tout à tous devra faire place à unevraie culture du dialogueau-delà des simples professions de foi et à l’existence de solides mécanismes alternatifs de résolution pacifique des conflits.
Au titre des principes fondamentaux de la République (titre 1, s/titre 3),d’importantes questions ont été élevées au niveau de principe constitutionnel, comme la préservation de l’environnementdes écosystèmes et des terres, la promotion de la participation des Guinéens de l’étranger, l’interdiction de la discrimination basée sur la couleur de la peau, le sexe et l’état physique,l’obligation de contenu local dans les actions de développement. Ces innovations sont en phase avec les attentes et préoccupations des citoyens et représentent des gages de prise deconscience d’enjeux nouveaux.
Au titre des libertés, droits et devoirs, pour la première foisdes mécanismes de protection des droits économiques et sociaux, comme l'accès à l'éducation, à la santé, et à un travail décent ont été introduit. Il faut également noter le maintien de l’interdiction de la peine de mort et de la criminalisationdes mutilations génitales féminines. Tout ceciconsacrele caractère moderne de notre société.
La mise en garde de la responsabilité personnelle lors de violations commises sur instructionet la protection juridique du refus d’instructionsillégales devraient mettre fin à l’impunité relative aux violencespolitiques massives pratiquées dans notre pays depuis l’indépendance etdont le procès des massacres du 28 septembre 2010s’est voulu être l’épilogue. Les dispositions sur l’inviolabilité du domicile et de la vie privée (Art 16) sont rassurantes, mais timorées par l’exceptionrelative à laprévention de « périls graves et imminents et de danger commun » (art.16, §4) quipourrait servir de base juridique à des abus des forces de défense et de sécurité sur les citoyens comme le pays en est coutumier. A la lumière des défaillancesde protection que les Guinéens ont souffert ces dernières années, une loi organique devrait permettre de remettre l’ouvrage sur le métier afin de mitiger ce risque.
Concernant la liberté d’expression, le projet de constitution reprend et précise les dispositions précédentes et confirme la régulation de la communication et de l’audiovisuel par une commission(s/titre 4) à l’image de la Haute autorité de la communication (HAC). En tant que citoyen, j’attends plus d’un Etat moderne. Le droit à une bonne information de la population par des médias de service public manque comme enjeu de société dans ce projet de Constitution, ainsi que l’épineuse question du traitementdesdonnées personnelles.Même si ceci peut être traité dans une loi organique, le risque que la question soit éludée au profit de logiques d’appareil est grand. Nos médias de service public devraient cesser d’être de simples échos des détenteurs du pouvoir pour devenir de puissants outils, autonomes et dotés de ressources adéquates leur permettant de contribuer à l’information, l’éducation, le vivre-ensembleet la cohésion nationale.
Sur la question des devoirs, l’obéissance des enfants aux parentsévoquée ausous-titre 2 art.33 §3me semble dénoter une approche dépasséede l’autorité parentale, vue dans les sociétés modernescomme un accompagnement et non une domination.L’obéissance ainsi prônéepeut nuire au développement de la pensée critique, de la confiance en soi et de l’autonomie des citoyens.Afin d’avoir des citoyens capables de prendre des décisions responsables fondées sur la compréhension du sens des règles plutôt que sur une obéissance par contrainte, peur ou chantage émotionnel, notre société devrait viser à faire coopérer l’enfant/le citoyen, plutôt qu’à le faire obéir ou le soumettre.
L’article 35 du sous-titre 2 relatif aux devoirsde participation aux élections, de préservation de l’unité nationale,de promotion de l’alternance et du pluralisme démocratique, de contribution à la préservation del’ordre constitutionnel est sans doute le plus novateur sur cette question et constitue une véritable rupture normative en comparaison des Constitutions de 2010 et 2020. Intériorisés par chaque citoyen, ces valeursciviques ainsi hautement proclamées pourraient êtrele gage d’un rapport nouveau entre l’Etat et le citoyen et contribuer à faire émerger une démocratie participative, inclusive et responsable.
Des institutions de la République
Le projet de Constitution 2025 introduit une réorganisation significative du paysage institutionnel guinéen. Parmi les évolutions notables figure la disparition de deux institutions majeures, le Conseil économique et social et le Médiateur de la République, qui, dans les Constitutions de 2010 et 2020, jouaient un rôle d’interface entre l’État et la société civile. SiConseil économique et social semble se retrouver un peu dans la nouvelleCommission nationale pour le développement,la mission du Médiateur de la République, notamment celle decanalisation des doléances sociales et detraitement des réclamations administratives hors contentieux, ne semblent, à ce stade, pas avoir été explicitement transférée à d’autres structures dans le nouveau schéma institutionnel.
Cette absence soulève des interrogations quant à la place désormais accordée à la recherche de solutions amiables notamment en matière de contentieux administratif. Si cette évolution reflète un recentrage des fonctions étatiques autour du Président de la République et du Parlement, elle appelle à une vigilance particulière afin d’éviter un affaiblissement du lien entre l’administration et les citoyens, et de prévenir d’éventuels engorgements du système judiciaire en cas de déficit de médiation.
Cela dit, le projet propose également une réforme ambitieuse du système institutionnel, marquée par la création de quatre nouvelles institutions :
- Le Sénat
- La Cour spéciale de justice de la République
- La Commission nationale d’éducation civique et des droits humains
- La Commission nationale pour le développement
Les deux dernières sont intégrées aux institutions d’appui à la gouvernance démocratique, et visent à renforcer l'ancrage de l'État de droit, des droits humains et de la culture citoyenne.
Avec l’introduction du Sénat, la Guinée passe d’un système monocaméral à un Parlement bicaméral, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’article 108 du projet présentele Sénat comme l’assemblée représentative des collectivités décentralisées et des composantes socioprofessionnelles de la nation. Il émet des avis sur certaines nominations aux hautes fonctions civiles et partage l’initiative législative sur des domaines clés tels que la décentralisation, les plans de développement, la cohésion nationale ou encore les référendums (art. 115).
Cependant, la méthode de désignation des sénateurs, dont un tiers est nommé par le Président de la République, limite l’autonomie représentative de cette chambre, notamment pour les corps intermédiaires comme les syndicats, le patronat ou la société civile. De plus, le lien structurel entre le Sénat et les collectivités décentralisées, qu’il est censé représenter, n’est pas précisé dans l’article 181 relatif à l’organisation territoriale. Ce flou pourrait poser des défis pratiques de légitimité et d'efficacité dans la représentation territoriale.
Enfin, la future loi de décentralisation (article 183) devra clarifier les attributions respectives du Sénat et de la Commission nationale pour le développement, afin de prévenir tout chevauchement de compétences ou conflits institutionnels, notamment dans les domaines de la planification, de l’allocation des ressources et du suivi des politiques territoriales.
La Cour spéciale de justice de la République : Inspirée d’expériences d’autres pays africains comme le Sénégal, le Bénin ou l’Afrique du Sud, la création de cette Cour traduit une volonté claire des Constituants : étendre la redevabilité jusqu’au plus haut niveau de l’État. Cette Cour est compétente pour juger le Président de la République, le Premier ministre, les ministres et hauts responsables pour des crimes ou délits liés à leurs fonctions.
L’article 161 définit la haute trahison du Président, tandis que l’article 162 encadre sa mise en accusation : elle peut être initiée par au moins 1/10 des députés de groupes différents et décidée par un vote aux deux tiers du Parlement réuni en Conseil de la Nation. Une procédure inédite permet aussi aux citoyens, via une pétition réunissant 50 % des électeurs inscrits, de déclencher un référendum révocatoire validé par la Cour constitutionnelle.Pour les autres hauts responsables, une loi organique fixera les modalités de poursuites.
Composée de 9 membres désignés par le Parlement et présidée par un magistrat issu des plus hautes juridictions du pays, cette Cour représente un dispositif inédit de lutte contre l’impunité au sommet de l’État. Si son indépendance, sa transparence et ses moyens sont garantis, elle pourrait faire de la Guinée un exemple régional en matière de gouvernance et d’intégrité institutionnelle
La Commission nationale d’éducation civique et des droits humains : Alors que les constitutions de 2010 et 2020 sont restées justes déclaratives sur les questions d’éducation civique et des droits humains, le projet de Constitution 2025 consacre explicitement une Commission nationale pour les prendre en charge,se montrant ainsi plus concret et plus actif.Cette commission aura également la responsabilité de vulgariser la Constitution et les lois et de favoriser leurs appropriations par les citoyens car une démocratie solide repose plus sur des citoyens éveillés que sur des lois écrites. Si la constitutionnalisation d’une telle Commission en tant qu’institution républicaine indépendante constitue sans doute une avancée, il va sans dire qu’elle ne sera opératoire que si des ressources adéquates et une autonomie de fonctionnement lui sont garantis et si elle est intégrée dans undispositif de collaboration avec l’Éducation nationale, les collectivités, les médias et la société civile.
La Commission nationale pour le développement : À la différence du Conseil économique et social (CES) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui n’avaient qu’un rôle strictement consultatif, la Commission nationale pour le développement s’impose comme une véritable institution transversale et proactive d’appui à la gouvernance. Dotée de larges attributions, elle se voit confier des missions de pilotage stratégique, d’analyse, de contrôle et de formulation de recommandations dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.
Par son champ d’intervention étendu, elle peut interagir avec un plus grand nombre de responsables de l’État que ne le permettaient les anciens conseils. Ce positionnement renforce son potentiel d’influence dans l’élaboration des politiques publiques.
Toutefois, si l’intention politique de faire participer cette institution aux processus décisionnels est à saluer, un point de vigilance subsiste : le mode de désignation de ses membres n’est pas précisé par le projet de Constitution. Il est renvoyé à une future loi organique, dont la qualité et les garanties seront déterminantes pour assurer à la Commission une véritable efficacité et un niveau d’indépendance suffisant, conditions essentielles à la crédibilité de cette innovation institutionnelle.
Les défis dans l’adoption et l’application de la nouvelle constitution
Des questions font polémiques autour de l’adoption de la nouvelle constitutionet son application. Ce qui est sain pour la démocratie et ne devrait donc pas être considéré comme un stérile débat. Au nombre des nombreux défis, retenons ceux qui font le plus polémique :
- Le choix d’un système hyperprésidentiel : Le projet constitutionnel confirme et renforce l’ancrage d’un régime hyper-présidentiel, sans qu’un véritable débat national sur la forme de l’État n’ait été organisé, commeau Tchad ou, dans une moindre mesure, au Togo, où la question de l’équilibre des pouvoirs a été portée dans l’espace public. Or, au regard de l’histoire politique guinéenne, un tel débat aurait été non seulement légitime, mais nécessaire.
Le projet de constitution prévoit ainsi que le Président de la République sera élu pour un mandat de sept ans, soit une durée plus longue que celles fixées par les Constitutions de 2010 (5 ans) et 2020 (6 ans). Peu convaincu par les arguments qui ontjustifié cette extension du mandat présidentiel, on peut simplement constater qu’il s’agit du mandat le plus long parmi les pays membres de la CEDEAO, dépassant même celui fixé par la Constitution malienne de juillet 2023 (5 ans).Par ailleurs, ce mandat présidentiel excède celui de toutes les autres institutions politiques et juridictionnelles, accentuant encore le déséquilibre structurel au sein de l’architecture institutionnelle. Ce choix confirme une tradition guinéenne de concentration du pouvoir entre les mains d’un homme fort, au détriment d’un véritable renforcement des institutions.
Certes, le texte introduit des dispositifs de destitution du Président, que ce soit par les institutions ou par le peuple (articles 161 et 162). Mais leur complexité interroge. En tant que citoyen, une question demeure : pourquoi recourir à des mécanismes de révocation aussi lourds, au lieu d’offrir plus fréquemment, tous les cinq ans, le droit au peuple de réévaluer la légitimité de ses dirigeants par les urnes ?
- La participation des responsables de la transitionaux futures élections : Le silence des dispositions transitoires sur la charte de la transition, notamment en ses articles 46, 55 et 65, laisse entrevoir une scène électorale ouverte dans la suite du processus de retour à l’ordre constitutionnel permettant à ceux qui conduisent la transition d’être candidats aux élections futures.En ce sens, ce qui est valable pour la Présidence de la République, l’est également pour le futur Parlement. Au-delà des procès d’intention, si notre Conseil constitutionnel accorde une telle possibilité, des dispositions fortes devront être prises pour que ceux qui seront désormais candidats àleurs propres successions n’en soient pas les juges.Pour y parvenir, dessolutions politiques robustesdevront être collectivement construiteslors de dialogues de la classe politique arbitrés par des acteurs indépendants.
- Le boycott de la nouvelle constitution par la classe politique :Plusieurs partis politiques qui existaient avant le coup d’Etat de 2021 appellent déjà le peuple à voter non lors du referendum de septembre 2025. Dans l’hypothèse que le oui l’emporte, quelle va être l’attitude de ces partis. Vont-ils reconnaitre cette nouvelle constitution et aller aux électionslocales et nationalesqui suivront ou vont-ils,à l’image de ce qui se passe en Centrafrique, refuser de la reconnaitre, elle et les institutions qui en seront issues ?
- La précipitation après l’adoption de la nouvelle constitution :Une vingtaine de lois organiques sont prévues pour affiner les dispositions de la nouvelle constitution. Elles sont la clé de voûte de l'application de la Constitution de 2025. Elles assurent la transition entre le texte fondamental et la réalité institutionnelle. Ces lois organiques comportent d’immenses enjeux car « le diable se cache dans les détails ». Ces lois, seront-elles toutes élaborées par le CNT ou par le nouveau parlement ?S’il va sans dire qu’un code électoral devra permettre l’organisation des élections aux niveaux local et national, une adoption hâtive et mécanique de ce derniercomporte d’importants risques pour la stabilité du pays. Il faudra par exemple convenir entre compétiteurs de l’ordre des élections, régionales-nationales-présidentielles ou toute autre formule permettant de bâtir des consensus et autres mesures de confiance afin de limiter les risques de désordre et de rassurer la classe politique.
Conclusion
Ce projet de Constitution, porteur d’une ambition réelle, s’inscrit clairement dans une dynamique de refondation politique et institutionnelle de la Guinée. Il constitue une opportunité historique pour repenser en profondeur les fondements de la gouvernance nationale.
Sauf surprise majeure, et malgré certaines zones d’ombre, son adoption par référendum le 21 septembre semble acquise. Toutefois, celle-ci ne marquera qu’une étape initiale d’un processus plus vaste. La mise en œuvre effective de la nouvelle architecture institutionnelle nécessitera l’élaboration d’une vingtaine de lois organiques, indispensables pour préciser et opérationnaliser plusieurs dispositions clés du texte constitutionnel.
Ce chantier législatif devra être accompagné d’un dialogue inclusif, respectueux des libertés fondamentales proclamées par la nouvelle Constitution. Il appartient au Gouvernement de transition de garantir l’ouverture de ce dialogue entre l’ensemble des acteurs politiques, afin d’éviter que la nouvelle Constitution ne soit perçue comme un instrument de légitimation du pouvoir en place, plutôt que comme un levier de transformation démocratique.
Les mois à venir seront décisifs. Ils diront si notre pays parvient résolument à construire une démocratie apaisée et partagée, ou s’il retombe inexorablement dans son cycle récurrent de violence et d’instabilité.
Oumar BALDET,
Consultant international,
Président de la Fondation Djamtum, Labé
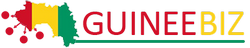


Commentaires