
Une fiscalité minière au service du développement ( Par Dr Mamadou Aliou Diallo)
Elle doit inciter les compagnies minières à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales. Dans l’ensemble, les législations ont échoué à ouvrir une protection adéquate aux populations locales et aux ressources naturelles dont elles dépendent. En comparaison avec les énormes moyens consacrés à l’évaluation et à la prévention des risques commerciaux liés aux activités minières, les moyens mis en œuvre pour estimer et atténuer les risques sociaux et environnementaux sont très faibles.
Les Impacts de l’exploitation minière sur les populations locales
Dans les années 2010 et 2020, le ralentissement de la croissance a provoqué une chute des prix internationaux. De nombreux pays africains disposant de ressources minières se sont trouvés confrontés à une crise de leur dette souveraine et les devises étrangères provenant de leurs exportations de minerais n’étaient plus ses « santés pour nuancer le remboursement des emprunts qu’ils avaient précédemment contractés. En dernier recours, la Banque mondiale s’est substituée aux prêteurs traditionnels, ce qui lui a donné la possibilité de réécrire la législation et la fiscalité minières dans toute l’Afrique. Cela s’est traduit par une diminution des taux d’imposition et par des allègements fiscaux au profit des compagnies minières.
Pour la Banque mondiale, en effet, la faiblesse des prix internationaux raréfiait l’offre de capital disponible pour le secteur minier. Les pays d’Afrique devaient donc se concurrencer entre eux pour attirer le capital-risque par des régimes fiscaux « compétitifs ». Nombre de ces lois ont donné carte blanche aux gouvernements pour négocier des accords fiscaux individuels avec les compagnies minières. De ce fait, les redevances, l’impôt sur les sociétés, les taxes sur les carburants, l’impôt sur les bénéfices exceptionnels sont inférieurs à ce qui est prévu par la loi. Il arrive même que les contrats exonèrent totalement les compagnies de tout impôt ou de quelque redevance que ce soit. Ces facilités, ajoutées aux incitations fiscales à l’exploration pratiquées par quelques-unes des économies minières les plus puissantes du monde pour leurs multinationales telles que l’Australie, le Canada et les États-Unis – ont favorisé la création de multiples entreprises d’exploration juniors qui ont obtenu des permis d’extraction, revendu leurs concessions ou essayé de réaliser des bénéfices rapides. Par exemple les sociétés canadiennes comptent désormais pour plus de 60 % des nouveaux investisseurs en exploration minière en Afrique. Sur les 1 220 sociétés cotées à la bourse de Toronto, cinq sur six sont des juniors.
our la Guinée, il existe 38 sociétés minière qui sont en pleine en activités. Ces sociétés sont jugées très risquées par les investisseurs institutionnels ; elles sont par ailleurs plus enclines à demander des régimes fiscaux dérogatoires aux États, en vue de convaincre des bailleurs de fonds potentiels. La montée en puissance de ce type d’investisseurs a nui à la qualité de l’investissement étranger direct dans le secteur minier africain récemment privatisé. Les juniors ont besoin d’énormes aides fiscales pour financer leurs opérations ; elles doivent dégager des bénéfices rapidement car leur activité ne s’inscrit pas dans une optique de long terme.
Enfin, elles sont, de fait, souvent moins sensibles à l’impératif de responsabilité sociale de l’entreprise. Il est fréquent que les multinationales qui cherchent à investir ou à développer leurs investissements en Afrique concluent des accords confidentiels avec les gouvernements pour obtenir des taux d’imposition et des allègements fiscaux particuliers, échappant aux cadres législatifs en place. Ces contrats commerciaux sont légaux ; ils prévalent sur la loi et le régime fiscal national.
Les populations vivant autour des mines
Elles continuent à être les victimes de l’activité extractive à grande échelle. L’État les protège en effet très peu contre la dégradation de leurs moyens de subsistance, de leur état de santé et de leurs ressources naturelles. Diminution des terres agricoles, contamination des sols et des eaux, pollution de l’air, déforestation, expulsions forcées, dommages aux habitations et cadre de vie dangereux tel est le coût de l’exploitation minière pour les populations locales. Les agriculteurs qui vivent dans les zones minières (BOKE), près de la fonderie de SIGUIRI (SAGUI) ont par exemple perdu des récoltes du fait des sédiments et des boues qui inondent les champs et les rendent inexploitables.
De ce fait, les agriculteurs n’ont pu cultiver des produits de première nécessité comme le chou, la tomate et le maïs pour leur consommation personnelle ou pour les vendre sur les marchés avoisinants. Pour 2020, la perte de revenus atteint pour les agriculteurs locaux 19 523 dollars. Ces rejets très fréquents ne sont pas le seul problème lié aux activités minières ; le 6 novembre 2016, un des pipelines de SIGUIRI a rejeté d’importantes quantités de liquide acide dans plusieurs rivières, dont le fleuve Niger – une des plus grandes rivières Bafing.
Accroître les recettes minières
De trop nombreux gouvernements africains refusent encore de soumettre les accords fiscaux qu’ils ont passé avec les compagnies minières et les recettes qui en découlent à l’examen de leurs parlements et de leurs citoyens. De trop nombreuses compagnies minières continuent de faire pression pour obtenir des exonérations fiscales et omettent de publier ce qu’elles gagnent et ce qu’elles versent aux gouvernements des pays où elles opèrent. La crise du crédit et la réduction des financements disponibles pour le secteur minier ne peuvent qu’inciter les gouvernements à poursuivre ces accords secrets ; de même, la crise fournira aux compagnies minières un prétexte idéal pour exiger de nouvelles exonérations.
Pour inverser le paradoxe de l’abondance, qui caractéristique de nombreuses sociétés africaines riches en ressources minières, il faut opérer des transformations radicales. Pour que le montant des recettes provenant du secteur minier soit adapté et qu’il soit dépensé de façon juste – c’est-à-dire en adéquation avec la stratégie nationale de développement décidée pour le pays –, les organisations de la société civile et les parlements doivent pouvoir suivre et superviser la collecte et l’affectation des recettes budgétaires et contrôler les dépenses réelles. Pour cela, il faut établir une nouvelle norme comptable internationale imposant aux multinationales la publication des sommes qu’elles versent aux gouvernements, les bénéfices et les dépenses réalisées dans chacun des pays où elles sont implantées.
L’International Accounting Standards Board (IASB) envisage d’introduire une norme de ce type pour le secteur minier. L’aboutissement de ce projet constituerait une importante réforme systémique, qui permettrait aux gouvernements et aux citoyens d’avoir une visibilité sur les lieux où sont payés les impôts et les montants versés par les compagnies minières. Il serait ainsi plus difficile de transférer les bénéfices entre les filiales. Il faut aussi réformer les régimes fiscaux du secteur ainsi que les États africains puissent bénéficier d’une juste part de la rente minière et financer leurs programmes de développement nationaux.
Dans certains pays, cela nécessiterait une augmentation des taux d’imposition et des autres taxes ; dans d’autres, il faudrait mettre fin à la pratique consistant à négocier des allègements d’impôts au cas par cas dans le cadre de contrats secrets. Les gouvernements africains doivent également réviser leur droit des sociétés et se doter d’outils juridiques permettant d’imposer aux filiales de multinationales minières implantées sur leur territoire la publication des informations financières requises par l’Initiative sur la transparence des industries extractives (ITIE). Ainsi, les compagnies minières de droit privé ou public – comprenant le nombre croissant de sociétés appartenant ou financées par l’État chinois – seront légalement tenues de publier leurs résultats et les montants qu’elles versent aux gouvernements.
Dr MAMADOU ALIOU BAH, Inspecteur Principal des Impôts
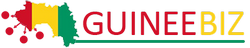


Commentaires