
En Guinée : l’absence d’autonomie fiscale ( Par Dr Mamadou Aliou BAH)
En Guinée, ce sont les difficultés financières et ainsi l’inévitable question fiscale qui poussèrent l’Etat à accepter la levée de l’impôt puis l’utilisation des sommes ainsi récoltées. Les puissants ont compris bien plus tôt l’intérêt qu’ils trouvaient à prélever de manière autoritaire les richesses des dominés que celui qu’ils avaient à se soumettre à des règles encadrant ces prélèvements. Contrairement à ce qu’une lecture rapide de la constitution et même le CGI pourraient laisser croire, l’évocation par des dispositions fiscales des ressources fiscales des collectivités territoriales ne conduit en aucun cas à leur conférer une quelconque autonomie en la matière. Le droit fiscal est présenté comme un droit de superposition. Pour déterminer sa situation fiscale, le contribuable doit évidemment appliquer les règles figurant dans le CGI ou, en l’absence de dispositions spécifiques, les seules règles de droit commun, qu’il s’agisse du droit privé ou du droit public. Le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des règles relatives à l’impôt. Dans la mesure où il se rapporte à des situations qui mettent toujours en cause la puissance publique, il est généralement considéré comme appartenant au droit public. La politique fiscale et la politique financière de l’Etat ne peuvent plus, de nos jours, être conçues et mises en œuvre sans que soit pris en considération l’ensemble des prélèvements obligatoires autres que les impôts. Selon la Constitution de 2010 (art. 72) : la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. La loi est donc la source essentielle du droit fiscal. Chaque année, le Parlement discute et vote, d’octobre à décembre, la loi de finances annuelle dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année suivante. Des dispositions fiscales peuvent eu outre être incluses dans d’autres lois ou dans des ordonnances prises par le pouvoir exécutif après autorisation du Parlement. Ces textes sont ensuite publiés au Journal officiel. Toutefois, selon la Constitution, le législateur ne peut ignorer certains textes internationaux : « Les traités ou accords internationaux […] ont […] une autorité supérieure à celle des lois » (art.76). En outre, des conventions internationales peuvent être signées entre deux Etats afin notamment d’éviter une double imposition des ressortissants ayant une activité ou un domicile dans les deux pays concernés ou bien de lutter contre la fraude fiscale par l’échange de renseignements notamment. Tout comme l’Etat, les collectivités territoriales doivent adopter chaque année des documents budgétaires qui à leur échelle ont une portée comparable aux lois de finances. Ainsi, les règles de droit relatives aux flux et à la gestion de l’argent public poursuivent toutes, de près ou de loin, un objectif de légitimation de l’impôt c’est-à-dire de son prélèvement puis de l’utilisation de son produit par les personnes publiques. Cet objectif et les règles qui le prolongent se retrouvent à deux niveaux qu’on peut qualifier de macroéconomique et de microéconomique. Dr MAMADOU ALIOU BAH, Inspecteur Principal des Impôts
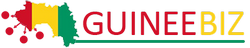


Commentaires