
La redistribution fiscale discriminatoire en Guinée ( Par Dr Mamadou Aliou BAH)
La discrimination du Code des impôts directs n’est plus en harmonie avec l’évolution économique actuelle. En ce qui concerne tout d’abord la source des revenus du travail, il est incontestable qu’elle se stabilise de plus en plus. Le fonctionnaire jouit d’une véritable garantie du traitement pendant toute sa carrière ; le traitement se prolonge au-delà de la retraite par le mécanisme des pensions. Quant aux travailleurs manuels, leur salaire se consolide également grâce aux différentes institutions sociales. La retraite des vieux a amorcé en Guinée le prolongement des revenus du travail au-delà de l’âge de 65 ans.
La distribution des dividendes est limitées tel point que le revenu variable d’autrefois devient pratiquement un revenu fixe. La substance des capitaux mobiliers est gravement compromise par les dépréciations monétaires qui se reflètent dans la hausse des prix mal dissimulés par la taxation actuelle. A certains égards, la deuxième étape de la réforme fiscale de 1958 à 1966 se focalisa sur des faits d’ordres politique et socio-économique très remarquables dans l’histoire de la Guinée : l’accession à son indépendance le 2 octobre 1958 et le changement de sa configuration fiscale cadrant véritablement aux aspirations de développement de la nation. A cet égard, le législateur guinéen procéda à l’élaboration d’une réglementation fiscale différente de celle du régime colonial de l’AOF. C’est ainsi qu’en décembre 1960, la plupart des lois fiscales dont l’application était confiée au service des contributions diverses furent votées. Ces lois contenues dans le journal officiel du 1er janvier et du 15 février 1961 entrèrent en vigueur. Sous leur forme, ces deux journaux officiels constituèrent un instrument assez difficile à manier car ne satisfaisant pas aux besoins réels du monde des affaires et même à ceux des agents de l’Administration fiscale. C’est ainsi que le ministère en charge des finances et du plan d’alors, en étroite collaboration avec le service des contributions diverses, eurent à mettre en œuvre un projet de Code des Contributions Diverses entériné par le pouvoir législatif. Il fut institué par la Loi n° 62 /AN/CP/66 du 20 mai 1966 et promulgué par décret n° 176/ PRG du 31 mai 1966. Ce document eut un intérêt certain tant pour l’administration fiscale que pour les contribuables.
En effet, pour imprimer un cachet particulier à cet outil, feu El hadj Saifoulaye DIALLO, à l’époque, ministre des finances et du plan s’exclama : « la fiscalité moderne tendant à devenir plus abondante et plus complexe, cette première édition du code des contributions diverses de 1966 sera régulièrement revue et corrigée afin que celui-ci ne perde pas son rôle d’auxiliaire utile aux fonctionnaires de l’administration fiscale et de moyen d’informations et de formation civique des contribuables ». Dans ce code, l’imposition sur le revenu y fut transcrite conformément aux dispositions des articles 125 à 248. L’assiette, les obligations déclaratives des contribuables, l’établissement des rôles, le recouvrement, le contrôle, les droits de communication, les sanctions fiscales et même les exploitations commerciales et non commerciales classées dans la catégorie des BIC, des BA, des BNC, des revenus liés aux salaires, etc. y furent également appréhendés par le législateur. Les dispositifs techniques de taxation de l’ensemble des revenus nets catégoriels réalisés ou acquis par le contribuable et frappés par l’IGR d’avec ses taux progressifs, bien que variant d’une époque à une autre étaient prévus par ce code et même par les textes régissant le régime fiscal de la Guinée française de 1955.
A titre illustratif, nous pouvons retracer les traits évolutifs de l’assiette fiscale des deux époques de 1955 et de 1966: par exemples, la tranche progressive de l’IGR qui était de 8 en 1955 est restée inchangée jusqu’en 1966 et même au-delà ; le taux minimum qui était de 5% en 1955 a baissé à 2% en 1966 ; le taux marginal qui était de 60% en 1955 n’a pas connu de variation jusqu’en 1966 ; mais seules les tranches de revenu imposables qui n’ont connu que d’importantes mutations à la baisse soit 181 000 FG en 1955 contre 101 000 FG en 1966 pour la tranche minimale de revenu taxable ; et au-dessus de 3 000 000 FG pour la tranche de revenu maximale en 1955 alors que celle de 1966 était de 5 000 000 FG.
En somme, il convient de noter ici que beaucoup d’aspects importants en matière de réforme fiscale entre les deux époques ont eu lieu et que nos lecteurs peuvent les trouver en annexe au présent document. Le troisième épisode de la réforme fiscale est celui de 1966 à 1991. Cette période a marqué positivement l’évolution du système fiscal de la Guinée : « l’innovation fiscale » due à l’institution d’un nouveau code appelé Code des Impôts Directs d’Etat (CIDE) institué par la loi N° 62/AN/CP/66 du 20 mai 1966 et promulgué par décret N° 176/ PRG du 31 mai 1966. Ce document mit un terme à l’usage du Code des Contributions Diverses de 1966 en matière de fiscalité directe dont les produits servirent à alimenter le budget national de développement ou budget de l’Etat tout court. Aussi, il embrassa certains textes de lois de finances initiales en matière de fiscalité directe sur le revenu que le système fiscal guinéen a connus mais qui n’étaient pas compilés dans un document unique.
Les nécessités de développement socio-économique du pays et l’enjeu des affaires et surtout la politique de développement vue sous l’angle de la Révolution dont l’Etat et le PDG fusionnés formant le Parti- Etat, sous la conduite du président Ahmed Sékou Touré, furent, certes des motifs valables de la réforme fiscale à cette époque. Evidemment, d’autres facteurs non négligeables seraient certainement à l’origine de cette mutation du contexte contributif guinéen ; mais pour notre part, nous nous intéresserons quasiment aux aspects juridiques concernant l’imposition du revenu dont le CIDE a pu transcrire en texte de lois fiscales.
Ce CIDE a été institué par l’ordonnance n° 91/018 / PRG/ SGG du 8 février 1991.
En effet, le CIDE a prévu en son article 4, des dispositifs régissant les impôts cédulaires liés aux revenus dont : l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux prévu par les articles 125 à 171 du CCD et 87 à 137 du CIDE, l’impôt sur les bénéfices non commerciaux prévu par les articles 172 et 173 du CCD et 138 à 152 du CIDE , la taxe d’apprentissage prévue par les articles 174 à 186 du CCD et 243 à 244 du CIDE , l’impôt sur les traitements et salaires prévu par les articles 191 à 209 du CCD et 50 à 86 du CIDE , l’impôt minimum forfaitaire prévu par les articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 090/ PRG/ SGG/ 87 du 30 décembre 1987 , la retenue à la source sur certains revenus non salariaux instituée par l’article 19 de l’ordonnance n° 083/ PRG/ SGG/ 89 du 30 décembre 1989. Tous les dispositifs juridiques (champ d’application, personnes imposables, assiette, taux, régimes d’imposition, régimes d’exonération, etc.) afférents aux impôts énumérés ci-dessus et transcrits dans le CCD et le CIDE sont annexés au présent document. La quatrième phase de la réforme fiscale concerne la période de 1991 à 2004. Il s’agit là d’une véritable ‘’révolution fiscale’’ que la Guinée ait connue.
En effet, bien avant la parution du CGI, les changements fiscaux consignés dans les différentes lois de finances (initiale et rectificative) n’étaient pas facilement saisissables par non seulement les agents de l’administration fiscale, mais aussi par les usagers et cela de 1992 à fin janvier 2004. En clair, les textes légaux et règlementaires en matière fiscale étaient dispersés dans maints documents par-ci et par- là.
Donc, les entreprises, les individus et le monde des affaires ne savaient à quel saint se vouer pour asseoir leurs impôts a fortiori déclarer et payer leurs droits. Ils étaient confrontés à d’énormes difficultés pouvant compromettre dangereusement la performance des finances publiques et plus précisément celle de l’administration fiscale. Pour pallier à ces difficultés majeures, les autorités du ministère de l’économie et des finances en étroite collaboration avec celles de la DNI , appuyées par les efforts louables de l’expert français, conseiller du directeur national des impôts (Bernard COURRAUX) et l’Assemblée Nationale ont jugé nécessaire de mettre en œuvre un nouveau code plus exhaustif et plus global embrassant les anciens codes segmentés de enregistrement, des impôts directs d’Etat et des contributions diverses),
Le système fiscal guinéen avant la réforme de 2004 a connu de véritables « innovations fiscales ». On peut citer entre autres l’institution de la TVA en 1996 suivant la loi n° L/ 95 /035 /CTRN du 30 juin 1995 complétée par la loi n° 009/95 du 28 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et du décret D/95/354/ PRG/ SGG du 28 décembre 1995 portant application de la TVA, de la TAF de la TCA ; et la suppression de la licence de certains corps socioprofessionnels: les commerçants grossistes et même détaillants de boissons alcoolisées ou non.
En somme, selon la pensée du professeur Jean Claude Martinez, toutes mesures ou propositions de réformes visent à mettre l’accent sur les points suivants : la simplification des règles d’assiette et de liquidation de l’impôt ; l’allègement et la meilleure répartition de la charge fiscale entre les contribuables ; la sécurisation des recettes de l’Etat ; l’élargissement de l’assiette fiscale. Il est aussi important, nous l’estimons, de noter que depuis 1984 jusqu’à nos jours, le gouvernement de la 2ème République guinéenne a mis l’accent particulier sur l’exploitation judicieuse d’importantes ressources naturelles dont dispose le pays sous l’impulsion du secteur privé. A cet effet, de nombreuses réformes dans le domaine réglementaire et en matière de politique économique, principalement, la libéralisation de l’économie ont été mises en œuvre. Ce libéralisme économique a relativement entraîné la croissance macroéconomique soutenable incluant le secteur de la fiscalité. Dans le domaine fiscal on peut citer par exemple l’institution des impôts synthétiques tels que la TPU, la CFU, des taxes indirectes sur le chiffre d’affaires notamment la TVA, la TCA, la TAF, etc. L’imposition du revenu qui fait l’objet de notre préoccupation, en fait, occupe une place relativement faible parmi une panoplie d’impôts et taxes qui composent la structure fiscale guinéenne. Cette faiblesse se justifie par plusieurs variables explicatives dont entre autres : le bas niveau de revenus de certains ménages d’une part et d’autres facteurs environnementaux relatifs à ce prélèvement obligatoire c’est-à-dire la mal gouvernance, l’incivisme fiscal, la défaillance de l’organisation de l’administration fiscale, manque de dispositifs techniques et financiers nécessaires pour l’établissement des banques de données fiscales, fraudes et évasions fiscales, les influences politiques de la classe au pouvoir, etc….
Dr MAMADOU ALIOU BAH, Inspecteur Principal des Impôts
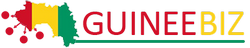


Commentaires