
La Petite vendeuse de soleil : Le film testament de Mambéty !
Le dernier court métrage de Djibril Diop Mambéty, La petite vendeuse de soleil, passe le jeudi 15 août 2011 à l’Institut français Georges-Méliès à 18h30. Occasion de voir ou de revoir ce bijou du cinéma africain. Histoire inoubliable d’une petite fille qui décide de changer son destin. Un objet filmique testament qui oscille entre film poétique et poème en images.
Ce film de 45 minutes est, par la force des choses, le dernier de Djibril Diop Mambéty ; le célèbre réalisateur est décédé le 23 juillet à Paris, avant la fin du tournage. Deuxième court métrage après Le franc (1995) et s’insérant dans la trilogie de courts métrages que le réalisateur sénégalais comptait consacrer aux héros ordinaires, les petites gens dont le quotidien n’est pas un long fleuve tranquille mais un véritable parcours du combattant. Cinéaste de la marginalité, de badou Boy (1965) au Franc (1995) en passant par Contra’s City (1968), Touki Bouki (1973) à Hyènes (1994), il a toujours filmé des hommes et des femmes qui sont borderline, à la marge de la société, mais avec ce film il interroge pour la première fois la marginalité dans l’enfance à travers les enfants de la rue.
Sili est une petite handicapée de douze ans qui mendie dans les rues de Dakar. Bousculée par les petits vendeurs de journaux à la criée, blessée dans son amour-propre, elle décide de gagner aussi sa vie en distribuant au quotidien le Soleil dans les rues ; il s’agit pour elle de gagner le respect des garçons de la rue tout en gagnant sa vie par la sueur et non la sébile. Défi himalayen pour un personnage affublé de trois grands handicaps : fillette dans un monde phallocrate, pauvre dans une ville sans pitié et handicapée au milieu des rues passantes où roues de voitures et piétons véloces ne la ménagent pas ! A côté de sa détermination, il y a Babou, un jeune garçon qui lui vient en aide et lui prouve qu’il y a toujours des hommes de bonne volonté dans ce monde impitoyable. Et c’est un peu aussi grâce à lui que Sili, la larve qui se traînait au début du film, devient le papillon rose qui danse, guillerette sur le fil de la vie.
Ce film est une ode à la détermination, un poème filmé qui célèbre l’irrésistible poussée de vie dans ce qu’elle a de plus tenue, une sève qui pousse et monte d’une fragile plante et éclate en gerbe sous le soleil. Telle est Sili. Petit chose fracassé, un corps de pantin désarticulé qui se meut difficilement sur des béquilles, pourtant en elle brûlent une énergie et une ténacité capables de déplacer des montagnes. Malgré son handicap, elle vendra les journaux, malgré sa pauvreté, elle refusera le billet de dix mille que lui tend l’homme, malgré les menaces des autres crieurs, elle ne renoncera pas.
Elle irradie les choses et les êtres comme si elle portait en elle le soleil. D’ailleurs, l’omniprésence sémantique et visuelle du soleil dans le film, le quotidien qu’elle distribue, ne s’appelle-t-il pas le Soleil ? Sili ne signe-t-elle pas en dessinant un soleil ? même sa cité, la Cité tomate (rondeur et rougeur), ne distille-t-elle pas l’image du soleil ? Le soleil est associé à la vie, à sa pétulance et à son éclat. Toutefois, même si le film se veut une ode à l’astre solaire, il ne sacrifie pas à l’esthétisme pur car Mambéty n’oublie pas que là où le soleil brille, il y a toujours l’ombre.
Aussi la Petite vendeuse de soleil conserve-t-il un aspect documentaire sur la ville africaine avec ses contrastes : vertiges des buildings à côté des gourbis du périph, traditions orales côtoyant la modernité, et riches citadins en costard dans des voitures cossues et pauvres hères à pied ou juchés sur des charrettes tractées par des chevaux faméliques.
Dans ce film, la caméra de Mambéty, d’habitude si virevoltante comme dans Touki Bouki, se fait lente, elle épouse le rythme traînant de l’héroïne Sili. Entre tableaux urbains et séquences rêvées, le film déroule des images qui ont la métrique et le tempo d’une ode. Et la musique de Wasis Diop, entre roots wolof, jazz et world, colore le film d’une atmosphère onirique et aérienne.
Film ultime, monté en l’absence du maître, on pourra gloser sur son angélisme et l’extrême théâtralité de certaines séquences, mais l’important est que cette oeuvre vaut par l’empathie du réalisateur pour sa jeune comédienne, Lissa Baléra, et surtout pour la grande poésie qui s’en dégage. Le film se clôt sur Babou (Taïrou m’Baye) portant Sili au dos et franchissant une porte de lumière. Le couple se dissout ainsi dans la lumière aveuglante du soleil. Au-delà de la porte de lumière, qu’est-ce qui attend les deux enfants ? Sûrement la récompense des persévérants. Et quel enseignement nous laisse Djibril Diop Mamabéty ? Que nous sommes tous faits de corpuscules de lumière, et qu’il tient à notre volonté d’illuminer nos vies et de nous habiller de lumière. En changeant la vie. Ce film est une belle leçon de cinéma et de vie !
Saïdou Alcény Barry
Source: Les Editions du Pays
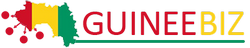


Commentaires